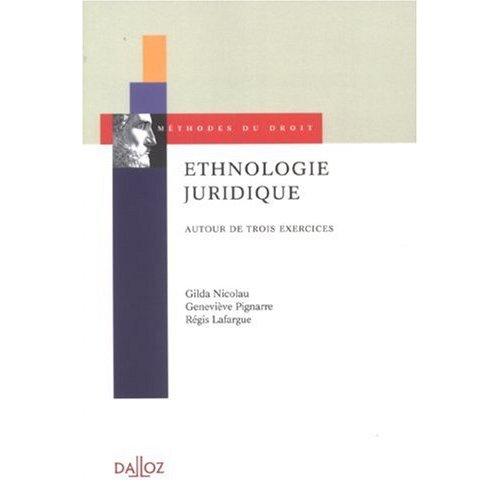
Gilda Nicolau, Genevive Pignarre et Rgis Lafargue,
Ethnologie juridique. Autour de trois exercices
Dalloz, Mthodes du droit, 2007, 423 p
LĠouvrage coordonn et crit (premire partie partage avec Rgis Lafargue et second exercice) par Gilda Nicolau, prsente une premire partie thorique suivie dĠune seconde plus pratique compose de trois exercices.
Les deux premiers exercices portent sur la coexistence du droit tatique et du droit endogne (coutumier) en Nouvelle Caldonie. Le second procde une comparaison du fonctionnement de la juridiction des mineurs en mtropole et en Nouvelle Caldonie devant un conflit de cultures. Le troisime traite de ce double contact travers la ngociation dĠune convention collective.
Le passage de lĠtude ethnologique (faite de descriptions ethnographiques et dĠanalyses dans les trois exercices), lĠanalyse thorique gnrale destine les relier et les comparer est aussi celui de lĠethnnologie lĠanthropologie (que lĠon peut aussi considrer comme synonymes). Le titre retient le plus petit dnominateur commun.
Les deux parties sont interdpendantes tout en pouvant tre lues dans le dsordre. La comparaison montre ici ses diffrences avec le droit compar dans la mesure o les objets sociaux observs appartiennent des domaines du droit en apparence trs loigns mais se rejoignent sur des points essentiels qui tiennent lieu de paradigmes (rintroduction du sens de lĠautre dans le droit, communication transculturelle ou dialogie).
La comparaison repose sur la recherche dĠquivalents homomorphes, c'est--dire de moyens employs par les socits pour parvenir aux mmes fins que le droit (tatique). A cette mme fin dĠquivalence, lĠouvrage prend le parti de nommer droit (avec une minuscule) ce droit endogne qui en possde bien les caractres gnralement reconnus.
Les auteurs sĠaccordant la collection Ç mthodes du droit È font une place essentielle la mthode ; lĠouvrage rpond dĠemble par la ngative la question de savoir si lĠethnologie juridique est une simple application des mthodes de lĠethnologie au droit. Il y a bien un syncrtisme disciplinaire qui va dĠailleurs bien au del des deux disciplines vises (Chapitre 1. changes et partages disciplinaires).
LĠouvrage montre que les mthodes dĠinvestigation de lĠethnologie viennent apporter des mthodes Ç de terrain È inusites par les juristes et avec elles, les acquis thoriques de lĠethnologie et de lĠanthropologie. La rencontre des disciplines produit aussi ses propres altrations rciproques ; les cultures juridiques, champ de lĠinterdiscipline sĠentendent ici dans leur sens dynamique, toujours en train de se faire et dfaire, et large (recouvrant tout le champ de la juridictit) ; le Droit tatique nĠen est quĠune partie avec lequel il y a lieu dĠtudier les relations.
Ainsi, le souci de lĠinteraction du chercheur avec le terrain observ, et partant la recherche dĠune objectivit autrement construite travers la description ethnographique, sĠajoute celui de ne pas plaquer dĠautres catgories et classifications que celles employes par les groupes observs. Partant, sĠil y a lieu dĠobserver les juristes, il faut aussi faire du droit la manire dont les juristes lĠentendent, ce qui est une diffrence essentielle avec les mthodes de la sociologie.
CĠest par ailleurs au droit, que lĠon empruntera la notion de dfinition stipulative (M. Troper, D. De Bchillon). Il sĠagit de sĠentendre sur lĠobjet sur lequel on travaille!
CĠest simplement une dfinition plus large que sĠaccordent les anthropologues du droit qui se placent notamment du point de vue des destinataires de la rgle et observent leur capacit dĠoptions juridiques ou non (forum shopping) ; lĠide de non-droit, dgage par le doyen Carbonnier, face cache ou invisible des juristes, constituant une des extensions du champ disciplinaire, est le domaine de prdilection de anthropologues de formation. Les tudes sont fcondes dont la confrontation celles des juristes permettent de stigmatiser tant le panjurisme (voir du droit partout), que les ethnocentrismes (voir la Ç coutume È ou le Ç droit spontan È lĠidentique du droit crit).
Au centre de lĠouvrage, une analyse rflexive de la notion dĠethnocide (destruction culturelle de lĠautre et partant de soi) pose en termes de responsabilit du droit ou de son ineffectivit, la permanence de la crise identitaire des socits occidentales et occidentalises. Les pathologies de lĠaltrit que connat la socit contemporaine sont attribues ce phnomne invasif. Il appartient la recherche juridique dĠlaborer des moyens de le combattre. LĠinstitutionnalisation dĠun principe de reconnaissance mutuelle, comme une approche transculturelle des droits de lĠhomme en font partie. LĠensemble de lĠouvrage et particulirement cette partie sont un hommage lĠethnologue Robert Jaulin.
Procdant une anthropologie du dtour, la confrontation du droit Etatique et de la Coutume juridique en Nouvelle Caldonie avec celle de la rencontre du Droit tatique (exogne) et du droit endogne du travail, offre un regard diffrent sur la part juridique du non droit tatique ou plutt sur leur co-mergence. Dans les exemples prsents, le droit se cre par phnomnes de procduralisation et en ralisent lĠendognisation (fabrication du droit de lĠintrieur dans un cadre tatique). De son ct, en fournissant un cadre juridique ce processus, le droit entre dans la socit par inculturation (par opposition acculturation gnralement impose).
Ce pluralisme juridique de fait (pas ncessairement organis par lĠEtat) ou multijuridisme nourrit actuellement les controverses doctrinales en anthropologie juridique, au point dĠoccuper lĠessentiel de la discipline.
Comme les contradictions font progresser les mthodes, lĠouvrage Ïuvre simplement pour une version plus mthodique (et thique) de lĠtude du dialogue entre droit et socit.